
|
N° 247 - SEMAINE DU 18 AU 23 FEVRIER 2021
|
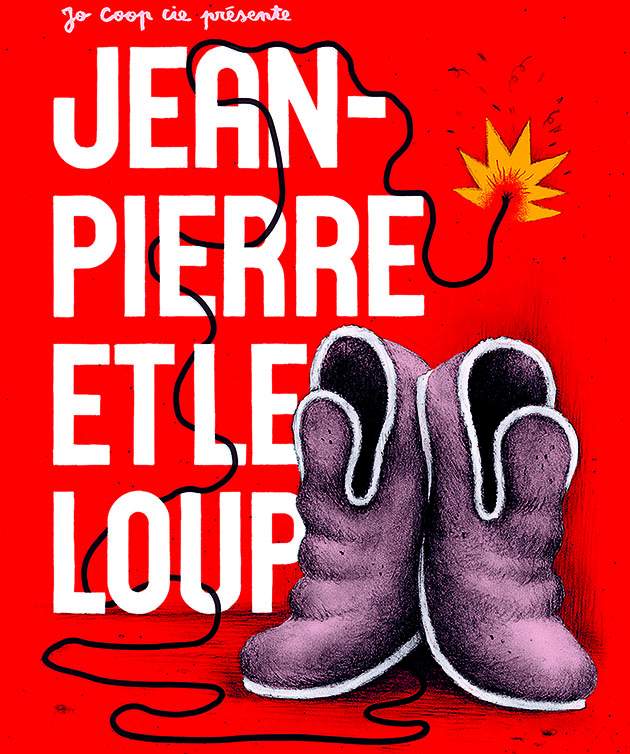
|
jean-pierre et le loup
On a encore vu un spectacle, la semaine dernière, on est presque gênée de vous le dire à vous, spectateurs malheureux de ne pouvoir retrouver le chemin des salles, mais on se dit que vous donner envie vous permettra de foncer dès sa sortie. Cette fois, c’était L’Estran, à Guidel, qui proposait un filage de la nouvelle création de la Jo Coop Cie, à destination des professionnels.
|
On suivait « Jean-Pierre et le loup » depuis plusieurs mois, on vous en avait parlé, et le résultat presque final est excellent. Encore quelques petits calages et on aura un spectacle formidable, dans lequel on est entrée sans réserve.
|
Jean Quiclet, comédien, et Stéphane Le Tallec, musicien, jouent ensemble depuis la première création de la compagnie, « Le petit Phil rouge », avec Catherine Pouplain, puis « Souvent la poésie m’emmerde », en duo. Ancré dans son rôle de guitariste, Le Tallec n’avait jusque-là jamais fait de pas de côté, c’est chose faite avec ce rôle formidable de chef d’orchestre échevelé, teuton et autoritaire, où il ressemble furieusement à Philippe Caubère.
|
C’est en tout premier lieu la bonne découverte du spectacle, l’éclosion d’une identité, mais aussi la synergie entre deux artistes, qui les fait grandir ensemble.
|
|
Quiclet se révèle, ça se confirme, dans la sensibilité, faisant évoluer son clown dans des contrées plus fragiles, plus oniriques, plus fines, et la complicité fait exister des personnages forts et bien dessinés, qui se complètent et s’enrichissent. Nous avons donc d’un côté deux clowns, un Auguste au nez de moins en moins rouge et un clown blanc, chef d’orchestre irascible, entre Karajan et Angus Young, dont la redingote dissimule des encoches à baguettes, dont il use et abuse au cours du spectacle. La narration fait alterner leur duo avec l’apparition de personnages joués par Quiclet, quatre résidents qui font l’Ehpad buissonnière. C’est là que nous avons décollé : avec rien – à part quelques effets lumière et son très simples – Quiclet nous embarque à la suite du vieux Jean-Pierre dans son escapade, et c’est tendre, joyeux, libre, et pas plombant du tout, pour nous qui avons d’habitude un peu de mal avec les spectacles sur la vieillesse.
|
|
On « voit » dans notre tête les tribulations de Jean-Pierre, Miss Cat, Bernard Mullard et Edith Pinson, juste par l’incarnation du clown, qui compose des figures de vieux très chouettes.
|
|

|
|
Photo ©Catherine Pouplain
|
|
|
La scéno, elle, vient emballer cette histoire qui pourrait très bien exister sans rien, mais lui donne du caractère, grâce à une esthétique marquée, très visuelle, entre esprit opéra et steam-punk, avec un magnifique orchestre de tourne-disques en rouge et noir, et une machine à faire les vinyles, digne de la Ligue des Gentleman extraordinaires, signée Brutalux. Toute une panoplie de trouvailles - dont deux paires de chaussons Rivalin ! - vient ponctuer le spectacle, souvent très réjouissantes, saupoudrées avec humour et fantaisie grâce à l’intervention de Nathalie Le Flanchec, qui œuvre avec talent au sein du Bouffou Théâtre, à Hennebont. Autre collaboration locale, celle avec Fritz Bol, graphiste lanesterien, qui signe l’affiche ci-dessus.
|
|
Enfin, résonne la baseline prémonitoire de l’établissement, – car écrite bien avant le confinement – la « Grande maison La retraite dorée » : « Etre enfermé, c’est être protégé. Et être protégé, c’est notre métier »
|
|
|
|
|

|
un jour un chapitre
On vous signale cette lecture originale, proposée par les Scènes du Golfe, àet faite par Jean Lambert-Wild en clown blanc au sein de différents lieux emblématiques de Vannes. Les treize chapitres de « Et si le soleil ne revenait pas » de l’injustement peu connu Charles-Ferdinand Ramuz, sont lus de manière assez classique mais très efficace, dans des vidéos où le comédien apparait dans des décors inattendus, comme le stade de la Rabine, filmé par un drône. Et c’est très chouette aussi juste à écouter, parce que c’est beau, Ramuz.
|
|
Jean Lambert-Wild vit avec son clown blanc depuis plus de vingt ans. Nommé Gramblanc, vêtu d’un pyjama rayé, blanc et bleu, il est d’abord apparu dans des situations de jeu extrêmes, appelées Calentures. Jean Lambert-Wild était jusqu'en novembre 2020 directeur du Théâtre de l'Union, Centre Dramatique National de Limoges.
|
|
|
|
|

|
|
|

|
fabrice thomas
|
A Port-Louis, dans la Galerie de l’Ephémère, rénovée en blanc épuré, on prendra plaisir à retrouver l’univers de Fabrice Thomas et ses vrais-faux collages, à la facture soignée. C’est frais, c’est pop, c’est coloré, et ça fait du bien de retrouver de l’art.
|
|
> C’est jusqu’au 22 février, 28, Grande rue, Port-Louis
|
|
|
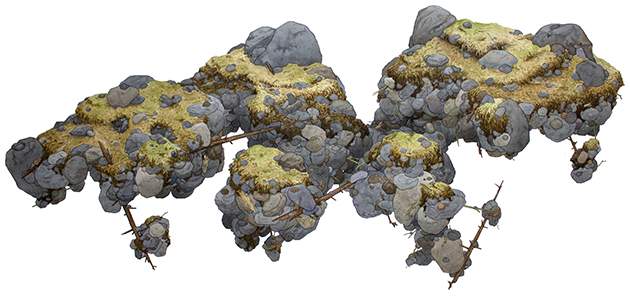
|
sylvain le corre
|
Chez Improbable jardin, on profitera des dernier jours de « Tourments » l’exposition de Sylvain Le Corre, dont on vous a déjà parlé (relire notre article ICI) et qui propose une dernière rencontre avec l’artiste avant la clôture de l'expo.
|
|
> Vendredi 19 février entre 15h et 17h, 26 rue du Maréchal-Foch, Lorient
|
|
|

|

|
|
On vous signale deux films de Philippe Garrel, un réalisateur qu’on aime bien, pour sa simplicité et son image, proche des grands photographes minimalistes à la Bernard Plossu. Héritier de Truffaut, pour ses personnages mi doubles, mi fiction, et ses histoires d’amour toutes simples, ses films oscillent entre grâce et ennui, entre sublime et longueurs, et ça, c’est pas mal. Parfait pour nous qui adorons les films où il ne se passe rien, mais où tout est dit - par l’image, ou les mots.
|
|
arte programme deux de ses films qui se répondent, en noir et blanc, l’un très brut, avec des relents du cinéma de Godard, « L’amant d’un jour » (2017, avec Eric Caravaca et Esther Garrel), l’autre plus léger et légèrement pétillant – « frizzante » - « L’ombre des femmes » (2015, avec Clotilde Courau – formidable – et Stanislas Merhar) (et Lena Paugam, comédienne de théâtre, du collectif Lyncéus, de Binic, tadam)
|
|
|
|

|
|
Et toujours sur arte, grâce à notre copine Véro, on s’est rendue compte qu’on avait oublié de regarder « Mademoiselle de Joncquières », d’Emmanuel Mouret, dans le cycle que la chaîne lui consacre, et que c’est un petit bijou qui n’a rien à envier au « Marie-Antoinette » de Sofia Coppola, côté plastique : une merveille esthétique, hyper chiadée en termes de costumes, de décors, de fleurs - ah, ces dahlias ! - de paysages lumineux et de couleurs, et formidablement interprété par une Cécile de France en état de grâce, loin de sa pétulance habituelle, délicate, sensible, vibrante, et Edouard Baer, en libertin sincère, amoureux de l’amour. Une variation autour d’un épisode de Jacques le fataliste, de Diderot, où les sentiments sont finement exposés, leurs nuances, leurs paradoxes, aux dialogues magnifiques, qui font entrer la philosophie et l’analyse des psychés et de la psychologie dans une histoire de vengeance et de dépit amoureux. Ma-gni-fi-que.
|
|
|
|
|

|
|

|
Nous on aime bien les déclinaisons de séries, quand les versions sont très différentes, comme l’excellent Hatufim, la série israélienne qui a précédé Homeland. Et voilà qu’on reçoit un texto qui nous dit « Hey ! House of cards sur arte ! ». Oui bon, on avait bien vu, mais non, on continuait à passer devant en chaussons sans se rendre compte que c’était la version british que diffusait arte. Ah mais oui ! Joie.
|
Alors qu’est-ce que ça donne ? C’est mieux, moins bien, différent ? Un peu tout ça à la fois.
|
La version US est puissante, avec des personnages charismatiques, beaux, inquiétants, séduisants, solaires, très dominants, élégants avec ostentation, écrasant tout sur leur passage, détruisant ceux qui s’opposent à leur ambition, à la Borgia. Kevin Spacey y frappe sa chevalière sur la table, faisant s’envoler un nuage d’hormones mâles, secondé par sa froide et carnassière épouse, Robin Wright, une sublime blonde hitchcockienne qui transcende la jupe crayon et l’encolure bateau. Deux personnages impitoyables qui cachent pourtant de grandes fragilités, voire des traumatismes, et portent en eux des ambiguïtés intéressantes à découvrir. (On parle de la première saison, parce qu'après, ça se barre sérieusement en sucette, jusqu'à une dernière saison carrément grotesque).
|
La version UK est subtile, élégante, la violence y est feutrée. C’est le vieux continent : les assassinats et les manipulations y sont perpétrés en costume sur mesure de Gieves & Hawkes, et on boit une tasse de thé en trafiquant des dossiers confidentiels. Le personnage principal, joué par Ian Richardson, semble être un réel politicien et non un acteur. Moins sexy que Spacey, sa liaison avec Susannah Harker, journaliste très curieuse (Kate Mara aux US) est beaucoup plus sulfureuse, voire perverse (la jeune femme l’appelle « Daddy » et tombe amoureuse de lui, quand même, beurk).
|
Dans la version US, les décors nous écrasent de leur couleur crème, ivoire, beige, blanc cassé, coquille d’œuf, beige, si chère à la Maison Blanche, mais aussi du gris contemporain de la cuisine des Underwood, à la fenêtre de laquelle ils partagent une cigarette, le soir venu. Ces décors très travaillés, qui font partie intégrante de la série, au même titre que des personnages, depuis les domiciles personnels jusqu’aux rues de Washington, filmées en contre plongée, tous les lieux ont une vraie signature, une identité, même la Maison Blanche, qui, pourtant filmée un nombre innombrable de fois, se révèle ici différente et habitée, dans des pièces que l’on voit rarement en images, les chambres ou la cuisine...
|
Dans la version UK, les décors, bah, ce sont ceux de l’Angleterre traditionnelle, entre Harry Potter et Laura Ashley, arches gothiques, bois sombres, manoirs et jardins anglais, fenêtres à vitraux. Cosy, chaleureux, définitivement anglais. Le domicile de la journaliste notamment, transpire l’esprit Mark & Spencer : murs abricot, suspension en macramé et rocking-chair, c’est plat et peu travaillé, très décor de séries télévisée à l’ancienne, mais ça reflète l’époque, et surtout, ça campe ce personnage, blonde girl aux airs de fille unique british, loin de la version US, beaucoup plus combative. Est-ce à dire qu’en 1990, les décors d’une série étaient moins importants ? Que les séries avaient moins de budget ? Ou que la théâtralité de cette version impliquait une réalisation moins sophistiquée ?
|
Là, clairement, la version US l’emporte. Clairs obscurs, cadrages au millimètre, portraits en gros plans magnifiques, et – ah, quel bonheur – symétries parfaites, jeux de lignes, de couleurs, de matières, il faut dire que c’est David Fincher qui filme et les premiers épisodes de la série sont un véritable chef d’œuvre graphique. Dans la version UK, ben, y a un mec derrière la caméra, point.
|
|
Les points vraiment communs aux deux séries
|
|
Le face caméra où le personnage s’adresse directement au spectateur, particulièrement subtil dans la version UK, fait de sourires à peine décelables et de regards en coin, alors que la version US était plus lourdingue.
|
|
La couleur shakespearienne, aussi marquée dans les deux versions, mais avec des énergies différentes, US à la Richard III et UK plus Macbeth… Des luttes, des trahisons, des complots, des meurtres, de la violence, du sexe, tout ça pour une seule chose : le pouvoir.
|
|
|
|
on a appris un nouveau mot
|
En faisant nos recherches pour cet article, nous avons découvert deux mots : sartorial et sartorialisme, tirés de l’anglais sartorial, celui-ci provenant du latin sartor, signifiant tailleur.
|
|
On connaissait « The sartorialist », célèbre blog de mode, pionnier du genre, et ses très belles photos de rue, reconnaissables par la technique du bokeh, cet arrière-plan flou lié à la profondeur de champ. Mais on ne savait pas ce que ça voulait dire. Et donc voilà, le style sartorial, selon wikipédia, « fait référence à l’art tailleur, aux vêtements masculins, réalisés dans les règles de l’art par un tailleur »
|
|
|

|
On vous relaye une info signalée par une de nos lectrices
|
"A Auray, circule l’idée, pas encore mise en place, du samedi de 14h à 15h, de faire ce qu’on veut, de la musique, danser, dire un poème, ou encore autre chose, devant le Petit Théâtre. La météo était mauvaise samedi dernier, à voir pour les samedis printaniers !"
|
|
|
|
|
|
|
|