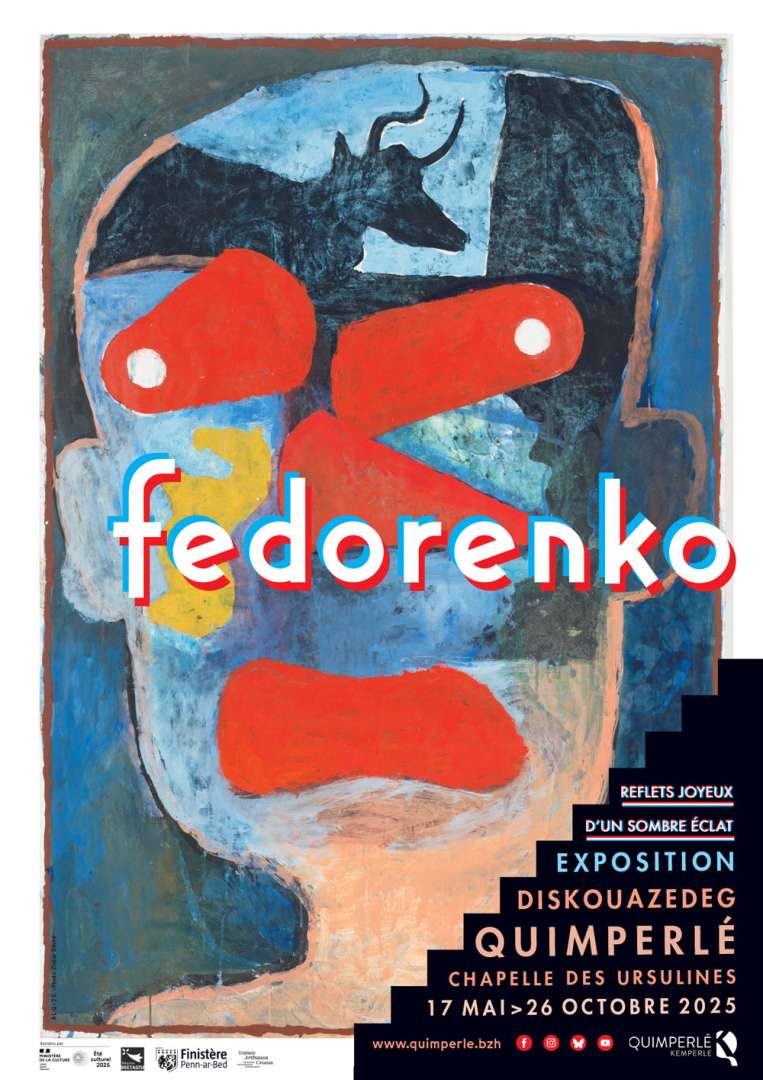Lorène Rouleau. Souvenirs d’une vague
21 février 2025. Isabelle Nivet

La première fois que j’ai rencontré Lorène, c’était à Lanester. Une dizaine de dessins – gravures plutôt, mais j’y avais surtout vu le dessin – avaient déclenché ce truc qui m’arrive quand je découvre un·e artiste. Un petit signal d’alerte interne qui dit « Ho Ho Ho, c’est bon ça », une envie irrépressible d’avoir une de ces œuvres chez moi, passer devant un café à la main, poser mon regard dessus quand je suis dans mon canap, m’arrêter au milieu du couloir pour la scruter. Le désir.
On s’est revues plusieurs fois. Et j’ai aimé sa manière d’être artiste : avec simplicité, honnêteté, modestie, oui. Lorène parle de son travail comme une artisane, sans verbiage ni jargonnage, sans endosser le costume parfois caricatural de l’AAArtiste. C’est super plaisant.
On est allées ensemble voir son exposition « Souvenir d’une vague » (quand on s’appelle Rouleau, c’est presque redondant), à la Galerie Tal-Coat. Sans palmes ni tuba, sans combi ni maillot, en gardant nos chaussures. Je n’ai même pas eu les pieds mouillés. Pourtant l’eau est là. Partout. Le son de l’eau, d’abord, comme si la mer était montée jusqu’à envahir la galerie en sous-sol. Le bleu de quelques projecteurs qui vient parfaire l’impression de grotte sous-marine. Et les regards échangés par Lorène avec les vagues.
J’ai découvert ça quand je me suis moi-même mise à dessiner : il y a des gens qui dessinent dans leur tête ou leur mémoire, et il y a des gens qui dessinent avec leurs yeux. Lorène fait plutôt partie de la seconde catégorie. Elle dessine ce qu’elle voit. Mais ce qu’elle voit, elle doit aller le chercher, avec un masque et un appareil photo étanche. Lorène dessine le dessous de l’eau. Littéralement. Enfin pas tout le temps, parfois elle dessine ce qu’il y a sous l’eau. Mais quand j’ai découvert son travail, c’était surtout ça : le dessous de la surface, presqu’à la surface, au plus près de la ligne de flottaison. Ce qu’on voit quand on est dans l’eau, à faible profondeur, et qu’on se retourne sur le dos pour regarder au-dessus de soi : la lumière, la couleur du ciel, les rides et ondulations de l’eau, les bulles. Une matière transparente, mouvante, fuyante. Les premiers travaux de Lorène racontaient ce dessous, parfois juste la matière, parfois avec des idées de corps : l’esquisse d’un bras, la bretelle d’un maillot, la lanière d’un masque.
Depuis, Lorène a continué à dessiner ce qu’il y a sous l’eau, mais plutôt le fond : les petits cailloux, les algues, la boue, les rochers. Elle se penche sur ce fond sans s’y perdre, reproduisant des formes qui n’en ont pas vraiment, de forme. Suivant des chemins qui n’en sont pas, des motifs sans début ni fin, produisant un paysage réel et abstrait, entre la cartographie et le relevé, un paysage qui envahit le papier pour former d’immenses panoramas marins, peut-être. Le changement d’échelle produit un trouble. On ne sait pas ce qu’on voit, on sent que, peut-être.
Car la technique est troublante. Si les premières gravures étaient produites sur un plexiglass enduit d’encre et recouvert de papier japon, créant des estampes en noir sur blanc, la série suivante, fabriquée pour l’exposition, a été faite sur des plaques de zinc de 25 centimètres par 50 centimètres, ajustées les unes aux autres pour former des pièces allant jusqu’à 2 mètres par 2 mètres, mais également autonomes : « c’est du zinc de toiture, recouvert d’une sorte de duvet noir – comme les cartes à gratter ! – que je grave par aplats ou hachures, beaucoup de traits. Je décalque la photo pour avoir une base et expérimenter le dessin, puis je reproduis à main levée ». Cette base de dessin décalqué permet d’accepter la réalité des vides ou des motifs que le cerveau pourrait être tenté de combler, de fermer ou d’enjoliver. Le noir des plaques est alors troué par les formes et les aplats qui révèlent le métal sur lequel les lumières bleues et orangées créent des reflets changeants.
Sont également exposées plusieurs séries, qu’on vous laisse découvrir : plantes, têtes, pièces en volume, collections…
> Jusqu’au 19 avril, Galerie Tal-Coat, Hennebont.
POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE THÉMATIQUE